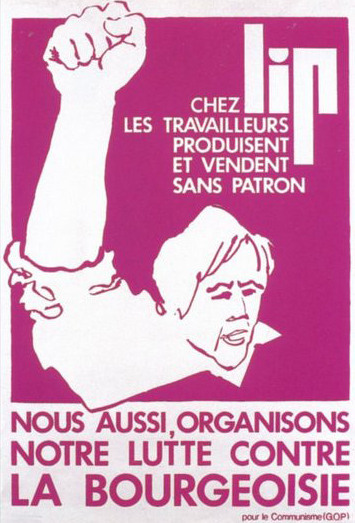En écho à "l'autogestion hier, aujourd'hui, demain".
Par Gilbert Dalgalian.
L’autogestion est à la fois une approche théorique pour approfondir la démocratie et des pratiques de démocratie directe. Sous ces deux aspects l’autogestion – comme ce livre, coordonné par le collectif Lucien Collonges, qui en déploie les nombreuses facettes – s’inscrit dans une histoire, mais aussi et surtout dans une actualité de crises multiples.
Comme pratique, l'autogestion est une réponse concrète immédiate aux urgences et aux régressions, ainsi qu'à la faillite de l'État (qui privatise jusqu'aux biens universels), de l'entreprise (soumise aux diktats de la finance) et de nombreux secteurs de la vie sociale pour lesquels la seule délégation de pouvoir ne garantit plus une gestion équitable et efficace. L'autogestion est une recherche permanente de solutions alternatives.
I. Le contexte historique.
Voyons d’abord ce contexte sur la longue durée. La démocratie directe, comme gestion ou contrôle citoyen, a toujours été présente, sous des formes et dans des limites variables, dans tous les systèmes sociaux. Aucun système social ni régime politique n’a réussi à l’échelle historique à occuper tout l’espace des pouvoirs et de la gestion des sociétés.
Ces espaces de démocratie directe se sont au fil du temps amplifiés sous les régimes de démocratie représentative (monarchies constitutionnelles, républiques). Les associations, les syndicats, les partis, les mutuelles, les coopératives sont – chacun à sa façon – des espaces de démocratie directe où la gestion et le contrôle ne sont limités que par le manque de vigilance de leurs membres et les dérives bureaucratiques.
La loi de 1901 sur le Droit d’association élargit l’espace de l’initiative collective non-étatique à un très grand nombre de domaines et d’activités. Cet espace n’est jamais complètement investi par les citoyens : il reste infiniment ouvert à l’initiative individuelle et collective.
Ces brefs rappels suggèrent que la démocratie directe est à la fois le contraire de la délégation de pouvoirs et son complément, voire son prolongement, indispensable. Elle en est le contraire, en ce sens que la délégation de pouvoirs est toujours un report des responsabilités sur des élus, donc une certaine forme de démission. Surtout en l’absence de mandats
impératifs et révocables ! Cet aspect atteint son paroxysme lorsque les démocraties dites représentatives sont vidées de tout contenu et usurpées par quelques élus (les caricatures les plus extrêmes pouvant s’appeler aujourd'hui Bush, Sarkozy, Berlusconi, ou Poutine).
Une autre caractéristique, omniprésente, de l’impuissance relative des citoyens sous les régimes de démocratie représentative est la puissance grandissante des lobbies (et des mafias) sur les élus et les institutions. Les lobbies sont des pouvoirs occultes ou déclarés, en marge des institutions, qui échappent à tout contrôle et à toute sanction, mais disposent de moyens de pression énormes, notamment par leur pouvoir de corruption.
Quant à la pratique généralisée des sondages d’opinion, elle consiste en fin de compte à faire dire ce qu’on veut à la “société civile” et à suggérer aux opinions publiques ce qu’elles doivent penser. Le sondage remplace le contrôle et confirme, en les mesurant précisément, la démission et/ou la démobilisation des citoyens.
En résumé, la démocratie représentative est contrecarrée par les multiples manières de la détourner vers des récupérations antidémocratiques et incontrôlées.
Pourtant la démocratie représentative peut aussi être le complément de la démocratie directe. Même dans une société d’autogestion généralisée, il subsistera forcément plusieurs niveaux où la gestion directe n’est pas possible : niveaux régional, national et international, ainsi que beaucoup de secteurs et services publics et d’intérêt général, qui tous relèvent encore partiellement d’une délégation de pouvoirs, complétée par une autogestion de leurs composantes de base.
Dans une telle société d’autogestion élargie, la culture démocratique elle-même change profondément au point de modifier le comportement des élus et les pratiques institutionnelles dans un sens autogestionnaire. L'information devient alors le fondement de pratiques nouvelles, mais aussi le lien entre les différents acteurs de la gestion et du contrôle.
À l’inverse, c’est toujours l’absence de culture civique et de mobilisation citoyenne – sur fond d'information lacunaire, parcellaire ou mensongère – qui permet aux lobbies d’occuper l’espace politique et aux élus d’usurper pour leur compte les pouvoirs qui leur sont délégués. Quand les zones de gestion et de contrôle directs se réduisent, la démocratie représentative elle-même finit par ne plus rien représenter, parce que la culture démocratique ne se nourrit plus d’aucune pratique.
Historiquement il y eut deux grandes tendances dans les tentatives de démocratie directe : le conseillisme (celui des Soviets en 1917-1919 qui combinait le contrôle direct avec le principe majoritaire) et les expériences d’autogestion (dont celles embryonnaires de la Révolution française et de la Commune de Paris). Mais aussi les expériences yougoslave, algérienne, polonaise, hongroise, tchèque et bien d’autres décrites dans ce livre et qui ont pour dénominateur commun la substitution au principe majoritaire d’une certaine prise en compte des minorités et de décisions prises au consensus.
Revisitons l’histoire de l’URSS. A sa fondation, l’URSS a démarré sur un socialisme conseilliste, les Soviets, avant de dégénérer en un régime de bureaucratie parasitaire, puis en terrorisme d’état, avec au final les reconversions stupéfiantes, à partir de 1991, de beaucoup de bureaucrates et dirigeants russes en néocapitalistes ultralibéraux, souvent maffieux. Dans les conditions d’un pays sous-développé tel que la Russie de 1917, aggravées par l'isolement de la Révolution russe et la guerre civile, seul un volontarisme d’État se traduisant par une philosophie politique explicitement auto-gestionnaire au niveau dirigeant aurait pu combler en quelques décennies le sousdéveloppement économique, politique et culturel : en impliquant directement les masses déshéritées dans le contrôle et la gestion de leurs terres, de leurs entreprises et de leurs communautés. Il n'existait – et n’existe - pas d’autre raccourci, pas d’autre autoformation accélérée que la prise de responsabilités. En l’absence de démocratie directe, au moins dans la volonté et le projet des dirigeants, les Soviets ne pouvaient qu’aboutir à la mainmise d’une caste sur ce qui était au départ un état anticapitaliste. La démocratie ouvrière des débuts s’est rapidement vidée de ses capacités de contrôle démocratique. Sans une visée autogestionnaire portée haut et fort – dans les conditions d'arriération du pays – le conseillisme a perdu sa vitalité initiale et a privé, à partir de 1919 et de plus en plus, le parti lui-même de sa démocratie interne et de sa capacité à promouvoir une démocratie vivante.
La conception conseilliste n’avait pas préparé les dirigeants bolchéviks à affronter le sousdéveloppement et les fortes dérives bureaucratiques et parasitaires qui en découlent toujours et partout. Ces dirigeants en furent d’ailleurs les victimes directes, assassinées par l’un des leurs, Staline, qui favorisa cette réaction thermidorienne qu’il parachèvera à partir des années 1930 en un régime autocratique et terroriste. Avec des multiples copies et métastases dans plusieurs États et partis en Europe de l'Est, en Asie et ailleurs.
Ici un mot d’ironie n’est pas hors de propos pour stigmatiser le discours dominant des vingt dernières années (au moins !) chez nos politiques et journalistes les plus en vue. N’amalgament-ils pas stalinisme et communisme chaque fois qu’ils évoquent la fin des régimes de l’Est ? (Au point que c’en est rentré dans le langage courant …). Ce faisant, ils attribuent à Staline et à ses successeurs une représentativité et une fidélité communistes aux antipodes de toute réalité historique : ils font comme si Staline avait, à leurs yeux, toujours menti sauf quand il se disait marxiste et communiste. Signe de leur part d’un aveuglement volontaire et sur Staline et sur l’idée communiste authentique qui anima au XXe siècle des millions de travailleurs et de citoyens, abusés par une réalité soviétique devenue félonie et travestie en “patrie du socialisme”. Amalgame réussi alors ? Oui, mais sur une mystification historique très médiatisée !
La conséquence durable de cette mystification stalinienne - qui se perpétua sous des formes nouvelles avec moins de Goulag jusqu’en 1990, puis s’est cristallisée en un méga-mensonge sur le prétendu “effondrement du communisme à l’Est” - c’est désormais la méfiance profonde des peuples à l’égard du socialisme en général et leur retard à comprendre la vraie nature des sociétés “libérales” en particulier. Journalistes et politologues en cour seraient avisés d'éviter les assimilations abusives qui ne renforcent pas leur crédibilité. Un début de prise de conscience prend corps aujourd’hui avec la naissance du mouvement altermondialiste. Mais celui-ci doit encore, aux yeux des masses, confirmer qu'il n'est pas lesté du ballast des expériences bureaucratiques-totalitaires et des amalgames qui ont accompagné leur déclin.
II. Les voies nouvelles de l’émancipation.
À l’échelle historique, l’humanité est placée devant une mutation essentielle et nécessaire de la philosophie politique dominante. S’il serait présomptueux à ce stade de vouloir en donner une définition aboutie, alors qu’une réflexion de fond longue et collective ne fait que s’amorcer, on peut en revanche en esquisser quelques paramètres fondamentaux.
L’émancipation à venir doit répondre à trois impératifs cruciaux : le dépassement radical de la délégation de pouvoirs ; la sortie d’un productivisme destructeur à la fois des liens sociaux et de la planète ; le remplacement de la course aux profits par une priorité à la valeur ajoutée sociale et environnementale, au profit de l'humain. En fait ces trois impératifs sont les trois facettes d’un même projet, celui de la désaliénation individuelle et collective, en un mot le socialisme d'autogestion. C’est également sur un tel projet partagé que pourraient s’entendre et se féconder trois courants politiques historiques, correspondant à trois aspirations distinctes, mais que tout concourt à réunir dans un avenir proche : l’aspiration à l’autonomie du sujet (surtout portée par les courants anarchistes et libertaires) ; l’aspiration à une autre gestion de la planète et un autre rapport à la nature et à la biodiversité (portée par les courants écologistes et les peuples de plus en plus confrontés aux dégradations majeures de l’environnement) ; l’aspiration à une sortie par le haut du travail aliéné et exploité (surtout portée par les différents courants marxistes depuis le XIXe siècle).
De cette fusion nécessaire et prévisible, nous avons déjà un début prometteur : le mouvement altermondialiste qui, aux trois aspirations ci-dessus, a su articuler toute une série de luttes sectorielles importantes, la défense de la petite agriculture paysanne, la lutte contre les OGM (qui menacent désormais d’envahir l’élevage après l’agriculture), la promotion des énergies renouvelables et non-fossiles, la remise en cause du tout-nucléaire, la priorité aux programmes internationaux (sanitaires, écologiques, économiques, éducatifs) en faveur du Sud. Et bien d’autres dont l’inventaire serait ici trop long.
Outre cette unification large de divers combats, l’altermondialisme a apporté une démonstration d’ordre méthodologique : les solutions ne peuvent émerger que d’un problème concret, le concept et la mise en forme institutionnelle viennent ensuite. C’est pourquoi la méthode autogestionnaire est le mode révolutionnaire le plus adapté à la complexité des enjeux, à la conflictualité des intérêts et des impératifs, souvent contradictoires, à la confrontation des points de vue “experts” et des besoins citoyens, à l’exercice des responsabilités aux échelons adéquats. En bref, méthode et culture de l’autogestion sont une approche à la fois révolutionnaire et pacifiante, radicale et progressive, respectant les minorités et favorisant les solidarités, la responsabilité et le droit à l’expérimentation.
III. Actualité de l’autogestion dans un univers de crises multiples.
Le capitalisme, à moyen terme, n’a plus les réserves d’expansion territoriale qu’il a connues au cours des siècles passés. La dernière expansion marquante fut son extension aux pays de l’Est après la chute des régimes bureaucratiques-totalitaires dans les vastes régions du monde qui jusque dans les années 90 échappaient encore à l’emprise du capital privé.
Certes, de brefs répits ou capacités d’expansion relative sont encore probables : l’investissement sur un “capitalisme vert” ; la relance grâce aux impacts de la révolution numérique sur la production, la consommation et les services ; un développement attendu des marchés intérieurs, notamment des pays émergents, BRIC et autres, notamment en Afrique. Mais, outre que ces “réserves d’expansion” vont exacerber les guerres économiques entre nations et entre oligopoles financiers, les bénéfices de cette expansion seront très inégalitaires partout. Il ne peut en résulter qu’une situation dans laquelle le capital va, au rythme même de cette crise multiforme et permanente et de guerres économiques, s’engager dans la recherche effrénée de taux de profits plus élevés sur le dos des peuples et des masses productrices de biens et de services.
En l’absence de nouveaux territoires d'expansion et de nouveaux marchés substantiels, c'est toujours la pression sur les salaires, les retraites, les acquis sociaux, les services publics et la sécurité sociale, qui reste l’ultime stratégie de retardement de la crise finale pour un système capitaliste, à terme privé de toute nouvelle expansion pouvant lui éviter l'irrésistible baisse tendancielle des taux de profit. La répression elle-même - et des plus violentes - est inscrite en filigrane dans ces nouvelles impasses et dans ces nouveaux rapports de forces. Elle peut s’avérer sanglante : ça s’est déjà vu … (D'autant que, face à cette crise profonde, toute avancée autogestionnaire ne peut qu'en favoriser la maturation).
Pourtant l’histoire n’est pas écrite d’avance. Et surtout “le savoir n’est plus l’apanage des classes dominantes” (Michel Fiant).
IV. Qu’est-ce que l’autogestion ?
Dans les luttes à venir il faudra compter avec l’accès de tous aux nouveaux outils d’information et de communication qui sont autant d’outils de contrôle et de gestion. Le contrôle des outils numériques et le croisement des fichiers par des organismes étatiques ou privés ne pourront pas neutraliser l‘impact démocratique de ces nouveaux outils et leurs effets sur le niveau d’information et d’éducation des citoyens et sur leurs capacités de contrôle et de gestion.
Nous sommes donc en présence d’une “nouvelle culture politique en gestation”. Mais elle n’est encore portée, ni même comprise, par aucune force politique conséquente dans les pays riches d’Europe et d’Amérique du Nord. C’est en Amérique latine et dans les mouvements altermondialistes des pays du Sud qu’on voit se dessiner les premières poussées autogestionnaires.
Ici se pose la question de la désignation :
Autogestion ? Autodétermination ? Autonomie ? Éco- socialisme ?
“Autonomie” comme “autodétermination” ne prennent pas en compte la dimension de gestion des entreprises et des services. “Éco-socialisme” qui fait l’impasse sur les peuples, les cultures, les minorités et les autonomies locales, ne convient pas non plus. Seul le terme “autogestion” englobe la totalité des aspects visés : l’entreprise, la société dans ses diverses institutions, les peuples et leurs droits culturels et linguistiques, ainsi que l’autonomie individuelle.
Mais l’autogestion est-elle un projet ou un modèle ? L’idée même de modèle est étrangère à la démarche autogestionnaire : celle-ci se veut confrontation d’intérêts parfois contradictoires, découverte de solutions négociées “en marchant” et droit à l’expérimentation.
Contrôle et gestion directe sont une méthode, pas un contenu, lequel reste à concevoir, inventer, pratiquer et affiner. Faut-il rappeler ici que Marx n’a pas écrit “Le socialisme”, mais “Le capital” ? Chez lui non plus le modèle n’était pas prédéfini. Donc un projet ? Oui, une “utopie concrète” en marche, une stratégie d’ensemble vers un objectif de gestion dans lequel l’efficacité repose sur la démocratie la plus radicale ; une succession de ruptures (que ce livre appelle les “temps-germes”) enclenchant une dynamique révolutionnaire. La première intuition de ces ruptures possibles et de ces moments-germes fut, dans l’histoire des théories politiques, le fameux “Programme de Transition” de Léon Trotski en 1938, dans lequel il énonçait déjà toute une série de ruptures partielles possibles, dont aucune en soi n’est une révolution, mais dont la dynamique est un engrenage de double pouvoir, puis de rupture complète avec le capitalisme.
L’aboutissement d’un tel processus est une nouvelle conception de l’État. Mais il faut d’abord éviter certains amalgames : les attaques de la droite et des politiciens libéraux ou sociaux-libéraux contre le tout-état sont des trompe-l’oeil. En réalité, leur pratique est tout le contraire de ce qu’ils prétendent ; ils renforcent partout les corps de contrôle et de répression étatiques, police, armée, justice, et vont jusqu’à transformer des dispositifs sociaux en instances de contrôle anti-social (pôle emploi, DASS, CAF, etc.). Même les médias n’échappent plus à ces mainmises par les sommets de l’État.
Leur critique du tout-Etat se limite donc au démantèlement des services publics, de la sécurité sociale, du Droit du travail et du Droit des affaires, dans le sens de la privatisation et du “tout est permis” aux patrons. Il ne s’agit en définitive que de préparer les conditions d’une pression accrue sur les salaires, les retraites, les niveaux de vie, en vue de l’affrontement qui reste le seul horizon de la mondialisation capitaliste. Ainsi le discours soi-disant anti-Etat est le camouflage d’un accaparement programmé de nouveaux champs d’investissements et d’exploitation. (C‘est aussi le corollaire d’une illusion à court ou à moyen terme : la sortie de crise par des taux de profit en hausse).
Il en ressort qu’il existe bien un interventionnisme d’état sur le périmètre du marché. “L’état structure le marché” : quand c’est Galbraith qui le dit, ajoutant qu’il n’y a pas d’autorégulation naturelle, on comprend que “le marché” est à la fois institution et idéologie. Ce, justement quand 'ils' prétendent le contraire.
Les mouvements d’émancipation en général et les altermondialistes en particulier doivent apprendre à gérer cette évidence : pour sauver les services publics, les retraites, les acquis sociaux et les conditions de vie, une autre régulation des marchés et un nouveau contrôle de l’Etat paraissent incontournables. Le dépérissement, toujours souhaité et jamais réalisé, de l’État doit d’abord passer - et pour une longue période - par de nouvelles instances de contrôle et de gestion. Ce sont celles-ci qui pourront définir les modalités, les rythmes et limites d’un tel dépérissement. Seule une autogestion généralisée peut décider quelles prérogatives l’État doit conserver, combien de temps et sous quelles formes. Seule l’autogestion permet de décider quels moyens d’intervention et de limitation des marchés l’État doit conserver.
Dans le triangle “État/marchés/autogestion”, ce n’est plus l’État (comme dans les régimes totalitairesbureaucratiques de l’Est), ni les marchés financiers (comme dans la mondialisation capitaliste) qui doivent décider : c’est l’autogestion qui dominera l’ensemble des instances politiques de décision. État et marchés doivent rester sous contrôle. Sous contrôle démocratique bien entendu ! Mais alors quel marché ? Pas le marché du travail, ni le marché des capitaux. En revanche, un marché des produits et des marchandises et surtout un pouvoir de décision sur les investissements. Ce qui met à l’ordre du jour et le plus tôt possible une socialisation du système bancaire, une politique du crédit pour investir mieux et pour partager les richesses, ainsi qu’une modification radicale des pouvoirs dans l’entreprise et les services. (Voir l'article Autogestion et marchés).
La démarche autogestionnaire met à l'ordre du jour l'accès du plus grand nombre aux outils et concepts économiques, en priorité aux acteurs de la production et des services. Une autogestion sans compréhension des fondements et mécanismes économiques serait la porte ouverte à toutes les manipulations de la sphère financière. Il faudra aussi concevoir des modalités spécifiques d’autogestion selon qu’il s’agit de biens universels (eau, biodiversité, environnement), de biens publics (dont font partie les moyens de production, mais aussi le logement et les transports) ou de biens collectifs (mutuelles, associations, coopératives). Seuls les biens privés (qui excluent les catégories précédentes) ne relèvent pas d’une autogestion collective.
V. Des souverainetés à redéfinir.
L'autogestion généralisée entraîne une remise en cause et une redéfinition des souverainetés. Tant qu'elle n'est conçue que comme 'nationale', la souveraineté souffre d’un double défaut historique : tantôt en raison de frontières imposées sous une domination coloniale ou étrangère, tantôt en raison de nations construites sur l’éradication des langues et des cultures des peuples que ces nations rassemblent, et souvent des deux défauts combinés. Sans aucune issue de sortie de cette impasse dans le cadre traditionnel de la démocratie représentative, où s'impose toujours une majorité dite 'nationale'. L’internationalisme n’est pas synonyme de cette éradication des spécificités culturelles, ni de sa négation lors d'ethnocides culturels. Au contraire, un internationalisme qui ne se réduit pas à un affichage idéologique doit respecter les langues, les cultures, ainsi que la volonté d’autonomie ou d’indépendance des peuples, régions ou minorités, lorsqu’elle est avérée.
C’est toujours la “souveraineté imposée” qui fait le lit des nationalismes et des récupérations de droite ou d’extrême droite du sentiment national ou des identités culturelles. La gauche française n’a pas échappé à cette dérive jacobine de la souveraineté éradicatrice : la conséquence n’a pas été le recul des mouvements culturels ou autonomistes, mais au contraire le renforcement de l’extrême droite la plus communautariste, en France en particulier. Le cas espagnol n’est pas fondamentalement différent, mais encore plus patent, du fait du passé franquiste.
VI. Repenser la forme « parti ».
L’autogestion, par sa méthode comme par ses finalités, est aussi construction d’un nouveau “bloc social à vocation majoritaire”, celui-ci étant le fondement sociologique de la nouvelle culture démocratique en gestation. Il en découle clairement que, dans un système d’autogestion qui conserve le pluralisme politique comme règle intangible, les partis politiques ne peuvent plus être ces vieux instruments plus ou moins dogmatiques et hiérarchisés, qui ont partout permis l'émergence d'avant-gardes autoproclamées.
L’objectif premier du combat autogestionnaire est bien de construire un « parti-mouvement » qui fédère et traduise l’ensemble des mouvements sociaux, revendicatifs et syndicaux autour d’un projet de société partagé. Ce n’est même plus le très minimal droit de tendances et de courants ; il s’agit au contraire d’organiser la conflictualité des intérêts et des besoins en un combat commun, respectueux de cette diversité sociopolitique. Le consensus doit y remplacer le trop fameux “centralisme démocratique” qui persiste encore dans les partis de gauche et en partie d’extrême gauche qui prétendent l’avoir dépassé.
Cette méthode consensuelle fait l'économie de toute auto-proclamation avant-gardiste du seul fait qu’elle s’appuie sur un “bloc social à vocation majoritaire”. En outre, l’absence de toute hiérarchie pyramidale se concrétise par la primauté et l’autonomie des “cellules de base” par rapport aux instances élues ou représentatives. Le “Parti de l’Autogestion” sera un parti autogéré. Le droit à la divergence est inscrit de façon automatique dans la libre discipline politique de tous.
Et si l’autogestion était cette “dictature démocratique” dont rêvait Karl Marx … .

 Degooglisons l'Internet
Degooglisons l'Internet